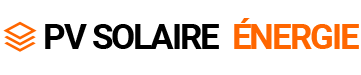Agrivoltaïsme en France : avantages, défis et perspectives d’avenir
L’agrivoltaïsme, pratique consistant à combiner production agricole et production d’électricité solaire sur une même surface, suscite un débat passionné en France. Alors que le gouvernement vise l’installation de 100 GW d’énergie solaire d’ici 2050, cette solution duale représente à la fois une opportunité et un sujet de controverse pour le monde agricole et énergétique.
Qu’est-ce que l’agrivoltaïsme ?
L’agrivoltaïsme désigne l’utilisation simultanée d’une même surface pour la production agricole et la production d’énergie photovoltaïque. Contrairement aux centrales solaires au sol classiques, les installations agrivoltaïques sont conçues pour être compatibles avec l’activité agricole, avec des panneaux souvent surélevés ou mobiles permettant le passage des engins agricoles.
Selon l’ADEME, l’agrivoltaïsme doit répondre à trois critères fondamentaux : maintenir ou améliorer la production agricole, contribuer à l’adaptation au changement climatique des exploitations, et participer au mix énergétique national.
Les arguments des opposants à l’agrivoltaïsme
La question de la nécessité énergétique
Les détracteurs de l’agrivoltaïsme remettent en cause sa légitimité dans le contexte énergétique français. Nicolas Bour, porte-parole du réseau Énergie Terre et Mer, souligne : « Nous sommes en situation de surproduction électrique. Les prix négatifs en journée, causés par la surproduction solaire, tirent vers le bas les revenus à l’export de l’électricité française ».
Jean-Raoul Tauzin de l’association EEDAM ajoute que l’électricité française est déjà décarbonée à plus de 95%, réduisant selon lui l’urgence du développement massif du solaire.
L’artificialisation des terres agricoles
L’argument principal des opposants concerne l’utilisation des terres agricoles. La Confédération paysanne s’appuie sur les données du Conseil national de la protection de la nature qui estime que « l’objectif de 100 GW de solaire peut être atteint en mobilisant exclusivement des surfaces déjà artificialisées ».
Myrto Tripathi, directrice générale de l’Institut TerraWater, considère que l’agrivoltaïsme n’a sa place que « dans les pays qui ne peuvent pas développer l’hydroélectricité ou l’atome ».
Les arguments des partisans de l’agrivoltaïsme
La nécessaire diversification du mix énergétique
Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables, rappelle que « l’électricité ne représente aujourd’hui que 40% du mix énergétique. Les 60% restants sont encore largement fossiles et doivent être décarbonés via l’électrification ».
Les partisans soulignent également la croissance de la demande électrique, notamment avec le développement des data centers qui pourraient consommer l’équivalent de « deux à trois réacteurs nucléaires ».
Les avantages agronomiques et économiques
Christian Dupraz, expert à l’INRAE, explique que l’agrivoltaïsme permet d’atteindre « un coefficient de rendement équivalent de 1,5 à 1,7 », signifiant une production globale 50 à 70% supérieure à une séparation des activités.
Jules Nyssen ajoute que « les projets agrivoltaïques affichaient un coût de production compris entre 70 et 74 €/MWh, soit un niveau que le nouveau nucléaire ne pourra jamais atteindre ».
Les bénéfices concrets pour les agriculteurs
Johan Bernardin, maraîcher en Champagne, témoigne : « L’agri-PV est un levier pour les jeunes agriculteurs. Il facilite l’accès au foncier et au crédit ». Après avoir repris la ferme familiale à 19 ans, il a pu, grâce à un partenariat avec Reden Solar, financer une serre agrivoltaïque de 1 MWc et créer 15 emplois en CDI.
Les installations agrivoltaïques peuvent également protéger les cultures contre les aléas climatiques (grêle, gel, canicule) et réduire les besoins en irrigation.
Les défis à relever pour un développement harmonieux
L’adaptation de la réglementation
Christian Dupraz pointe une incohérence dans la réglementation française : « Elle autorise des installations réduisant la lumière de 30 à 50%, tout en exigeant un rendement agricole ne baissant pas de plus de 10%. C’est physiologiquement impossible ». Il préconise une réduction du taux de couverture ou l’utilisation de panneaux mobiles.
La répartition équitable de la valeur
Bernard Ader, agriculteur en Haute-Garonne, souligne l’importance de « mettre en place des mécanismes de partage de la valeur pour éviter les frustrations ». La Chambre d’agriculture de son département propose d’ouvrir 51% du capital des sociétés de projets agrivoltaïques à tous les agriculteurs.
Une plus grande implication des collectivités territoriales dans les projets est également nécessaire pour assurer leur acceptabilité sociale.
Perspectives et conclusion
L’agrivoltaïsme représente une solution prometteuse pour concilier transition énergétique et souveraineté alimentaire, mais son développement doit s’accompagner de garde-fous solides. La recherche, notamment menée par l’INRAE, continue d’affiner les modèles pour optimiser la coexistence entre panneaux solaires et cultures.
Le débat entre partisans et opposants, comme celui organisé par GLHD et l’INES, reste essentiel pour faire émerger un consensus sur la place de l’agrivoltaïsme dans le paysage énergétique et agricole français.

Engagée pour la transition énergétique, je me consacre à l’exploration des opportunités offertes par l’énergie solaire et à son évolution. J’accompagne les professionnels du secteur et favorise les collaborations pour accélérer l’adoption de solutions durables et innovantes.
Abonnez-vous maintenant à la Newsletter.
Inscription gratuite !
Commentaires
- Il n'y a pas encore de commentaires.